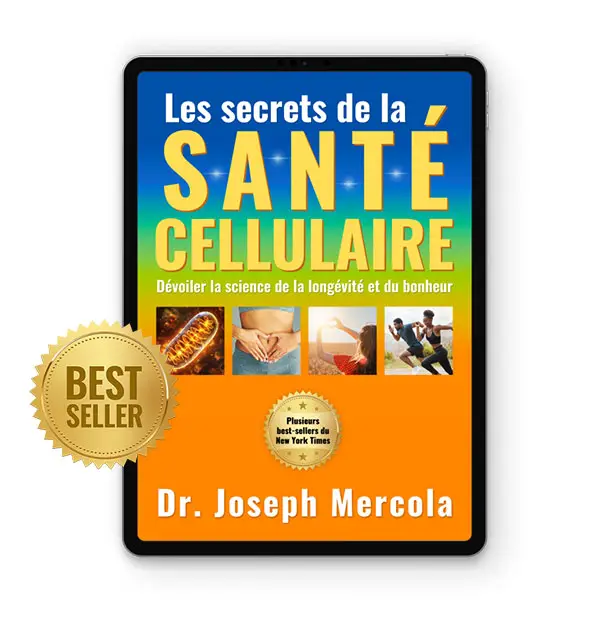📝EN BREF
- Les probiotiques influencent la santé cardiaque en améliorant le microbiote intestinal, ce qui réduit l’inflammation, régule la glycémie et abaisse le cholestérol : autant de facteurs clés de la maladie coronarienne.
- Une synthèse publiée dans Cureus, évaluant dix études menées sur l’homme, a constaté des bienfaits cardiovasculaires constants chez des personnes souffrant de diabète, d’obésité, d’hypercholestérolémie et d’hypertension.
- Certaines souches, telles que Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium lactis, se sont montrées plus efficaces que d’autres en réduisant la tension artérielle, le cholestérol et l’inflammation systémique, grâce au renforcement de la barrière intestinale et au rétablissement de l’équilibre microbien.
- Les probiotiques réduisent les métabolites nocifs comme le lipopolysaccharide (LPS) et l’oxyde de triméthylamine (TMAO), deux substances qui provoquent des lésions vasculaires et une accumulation de plaque, associées aux risques d’infarctus et d’accident vasculaire cérébral.
- Cette synthèse confirme que réensemencer son intestin avec les bonnes souches est une approche concrète pour protéger son cœur, particulièrement lorsqu’elle est associée à une alimentation non transformée et à des modifications ciblées du mode de vie.
🩺Par le Dr. Mercola
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies cardiovasculaires emportent près de 18 millions de vies chaque année, ce qui en fait la première cause de mortalité dans le monde. La maladie coronarienne est la forme la plus courante, caractérisée par une accumulation de plaque qui rétrécit ou obstrue l’arrivée de sang au cœur.
Elle débute souvent par des symptômes discrets, tels qu’une fatigue, une sensation d’oppression thoracique ou un essoufflement. Mais sans intervention, elle peut évoluer vers un infarctus, voire une mort subite. La bonne nouvelle est que cette pathologie ne s’installe pas en un jour, ce qui laisse le temps d’inverser la tendance.
La santé intestinale représente justement un levier essentiel pour y parvenir. Une synthèse récente indique que réensemencer son microbiote intestinal avec des souches bactériennes bénéfiques peut soutenir la santé cardiaque.
Une synthèse récente apporte des preuves solides d’un lien entre les probiotiques et la réduction du risque de maladie coronarienne.
Une revue de la littérature scientifique, publiée dans Cureus, a examiné l’influence des probiotiques sur le risque cardiovasculaire, et plus particulièrement sur la maladie coronarienne. Cette analyse a passé en revue divers essais cliniques, méta-analyses et études randomisées contrôlées pour déterminer l’impact de différentes souches probiotiques sur les principaux facteurs de risque des maladies cardiaques.
• L’analyse a porté sur un large éventail de participants : Elle incluait des personnes diagnostiquées avec une maladie coronarienne, mais aussi des adultes suivis pour un diabète de type 2, une hypercholestérolémie, une obésité ou une hypertension, soit des populations particulièrement exposées aux accidents cardiaques.
• Les chercheurs se sont concentrés sur dix études humaines majeures : Celles-ci comprenaient sept essais randomisés contrôlés et trois méta-analyses. Chacune de ces études impliquait des participants humains souffrant de maladie coronarienne ou présentant ses principaux facteurs de risque.
• La diversité des données utilisées constitue un point fort de la méthodologie : Les essais provenaient de pays tels que les États-Unis, l’Iran, la Chine, la Thaïlande, la Grèce et le Japon. Les résultats ne sont donc pas liés à une ethnie ou une population géographique unique, mais représentent un ensemble de données bien plus vaste, ce qui renforce la portée des conclusions pour différents modes de vie et patrimoines génétiques.
• Les recherches ont systématiquement démontré que les probiotiques avaient des effets bénéfiques mesurables sur les facteurs déclencheurs des maladies cardiaques : Il s’agit notamment de la tension artérielle, du cholestérol, de la glycémie, de la gestion du poids et de l’inflammation. Selon les chercheurs :
« Plusieurs facteurs de risque contribuent au développement de la maladie coronarienne, à savoir l’hyperlipidémie, l’hyperglycémie, l’hypertension, l’inflammation et le stress oxydatif. Ces éléments accroissent le risque d’athérosclérose chez les patients, conduisant in fine à la maladie coronarienne.
Ces dernières années, des preuves de plus en plus nombreuses ont établi l’effet bénéfique du microbiote intestinal sur la modulation de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Cet écosystème microbien joue un rôle significatif dans la régulation métabolique, la fonction immunitaire et l’inflammation systémique, des aspects tous déterminants dans l’apparition et l’évolution de la maladie coronarienne ».
• L’étude a mis en lumière des souches bactériennes aux bienfaits notables : Par exemple, Lactobacillus acidophilus exercerait un effet plus marqué sur le cholestérol que d’autres souches, tandis que les bifidobactéries offriraient une protection contre l’athérosclérose, notamment en association avec un traitement hypolipémiant. Bacteroides vulgatus et Bacteroides dorei contribuent quant à eux à prévenir la formation de plaque athérosclérotique.
Les probiotiques améliorent la santé cardiaque en corrigeant le déséquilibre intestinal à la source.
Mais comment les probiotiques agissent-ils précisément, au niveau cellulaire, pour protéger le cœur ? Les chercheurs ont souligné plusieurs mécanismes biologiques clés, mis en évidence par les études analysées.
• Réduire l’inflammation en renforçant la barrière intestinale : L’article souligne que la dysbiose altère la paroi intestinale, permettant à des endotoxines comme les lipopolysaccharides (LPS) de passer dans la circulation sanguine. Ceci déclenche une inflammation qui contribue au dysfonctionnement endothélial et à l’athérosclérose.
Les essais ont montré que des souches comme Lactobacillus rhamnosus et Bifidobacterium lactis réduisaient les taux de LPS et de cytokines inflammatoires comme l’IL-1β, diminuant directement la charge cardiovasculaire.
• Faire pencher la balance des acides gras à chaîne courte (AGCC) vers des molécules protectrices pour le cœur : Les AGCC sont des sous-produits de la fermentation bactérienne qui influencent considérablement la santé métabolique. L’étude a constaté que les probiotiques favorisent la production de propionate, un AGCC qui réduit l’inflammation vasculaire et la synthèse de graisses dans le foie. Dans le même temps, ils limitent l’acétate, qui, en excès, stimule le stockage des graisses et la synthèse du cholestérol.
L’acétate est généralement bénéfique, car il soutient la production de mucus. Mais un excès peut avoir des effets néfastes, d’où l’importance de l’équilibre. Ce rééquilibrage favorise un profil lipidique sanguin sain et allège la charge pesant sur le système cardiovasculaire.
• Réduire la production d’oxyde de triméthylamine (TMAO) par les microbes intestinaux : Le TMAO est un composé généré lorsque certaines bactéries intestinales dégradent des aliments comme la viande rouge et les œufs. Un taux élevé est associé à l’accumulation de plaque artérielle et aux crises cardiaques.
L’étude a révélé que certains probiotiques, comme Lactobacillus plantarum, modulent le métabolisme des acides biliaires et suppriment les bactéries productrices de TMAO, réduisant ainsi ce risque. Une analyse distincte a établi qu’un taux sanguin élevé de TMAO multipliait par quatre le risque de décès, toute cause confondue, dans les cinq années suivantes.
• Équilibrer la tension artérielle via les voies de l’oxyde nitrique et de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) : Des souches spécifiques, comme Lactobacillus helveticus, régulent la pression artérielle en influençant l’oxyde nitrique (une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins) et en inhibant l’activité de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, qui l’augmente.
Une méta-analyse incluse dans la synthèse a constaté qu’une dose probiotique d’au moins 10¹⁰ unités formatrices de colonies (UFC) réduisait à la fois la pression systolique (le premier chiffre) et diastolique (le second), en particulier chez les adultes âgés hypertendus.
• Améliorer le métabolisme du cholestérol : Certains probiotiques influencent la façon dont l’organisme traite le cholestérol. Par exemple, Ruminococcus aide à convertir le cholestérol en acides biliaires excrétés, tandis que d’autres souches l’incorporent dans leurs propres membranes ou le transforment en formes non absorbables comme le coprostanol. Ces actions réduisent les taux de lipoprotéines de basse densité (LDL) circulantes et ralentissent la formation de plaque.
• Réguler la glycémie et la sensibilité à l’insuline : Les probiotiques comme Bifidobacterium lactis augmentent le GLP-1, une hormone qui stimule la sécrétion d’insuline et ralentit la vidange gastrique, deux éléments essentiels à une glycémie stable. Ils réduisent également le stress oxydatif et améliorent la réponse cellulaire à l’insuline, diminuant ainsi le risque de diabète de type 2.
Chacun de ces mécanismes illustre comment un microbiote intestinal plus sain, soutenu par les bons probiotiques, génère un effet d’entraînement bénéfique sur l’ensemble du système métabolique. Ces résultats démontrent non seulement l’influence des probiotiques sur la santé intestinale, mais aussi comment ces changements se répercutent pour atténuer les déclencheurs biologiques de la maladie coronarienne.
« Les probiotiques ont démontré des mécanismes efficaces pour contrôler les facteurs de risque et réduire la maladie coronarienne. Leur effet est produit par de nombreux mécanismes, tels que leur rôle anti-inflammatoire et antioxydant », ont conclu les chercheurs.
« D’autres mécanismes ont été abordés principalement par la réduction ou la prévention des facteurs de risque de la maladie coronarienne, obtenue grâce aux effets anti-glycémiants et antihypertenseurs des probiotiques et par la diminution des troubles métaboliques. Ceci prévient ensuite l’obésité et l’hypercholestérolémie, ce qui confirme le rôle efficace des probiotiques dans la prévention de la maladie coronarienne ».
La consommation de probiotiques aide à normaliser la tension artérielle.
Des études antérieures ont également apporté des preuves sur la façon dont les probiotiques aident à réduire les incidents cardiovasculaires en modulant des facteurs de risque comme l’hypertension. Par exemple, une analyse de neuf études examinant le lien entre la tension artérielle et la consommation d’aliments riches en probiotiques ou de suppléments a donné des résultats favorables.
• Les personnes prenant régulièrement des probiotiques présentent une tension artérielle plus basse que les autres : En moyenne, leur pression systolique était inférieure de 3,6 millimètres de mercure (mm Hg) et leur pression diastolique de 2,4 mm Hg. Les avantages les plus significatifs semblaient concerner les personnes dont la pression artérielle était supérieure à 130/85, et les probiotiques contenant une variété de bactéries abaissaient la pression artérielle dans une plus large mesure que ceux contenant un seul type de bactéries.
• Le kéfir a démontré des effets antihypertenseurs et plus encore : Dans une étude de 2018 publiée dans la revue FASEB, des chercheurs ont mené une expérience sur trois groupes de souris — un groupe souffrait d'hypertension et a reçu du kéfir, l'autre souffrait d'hypertension, mais n'a pas été traité, et le troisième avait une tension artérielle normale et n'a pas été traité. Ils ont constaté que les rongeurs nourris au kéfir présentaient non seulement une tension artérielle normalisée, mais aussi :
◦ Un meilleur équilibre des bactéries bénéfiques dans l’intestin
◦ Une structure intestinale améliorée avec une perméabilité réduite
◦ Des taux plus faibles d’endotoxines
◦ Une inflammation moindre dans le système nerveux central
« Nos données suggèrent que les mécanismes antihypertenseurs du kéfir impliquent une communication axe intestin-cerveau durant l’hypertension », ont conclu les chercheurs.
• Une étude antérieure sur l’animal a établi que les probiotiques aident à prévenir l’hypertension induite par un régime riche en sel : Publiée dans la revue Nature, elle rapporte que la bactérie Lactobacillus Murinus prévient efficacement l’hypertension sensible au sel en modulant les lymphocytes T auxiliaires 17 (TH17). Lorsque cette souche probiotique était administrée aux souris, elle les protégeait des effets néfastes d’une consommation excessive de sel.
« Nos résultats relient une consommation élevée de sel à l’axe intestin-immunité et soulignent le microbiote intestinal comme une cible thérapeutique potentielle pour contrer les affections liées à la sensibilité au sel », ont conclu les chercheurs.
Associer probiotiques et nutriments végétaux potentialise leurs effets.
Bien que les probiotiques seuls soient bénéfiques, il est possible de potentialiser leurs effets. Une méthode consiste à les associer à des composés végétaux bioactifs. Une synthèse publiée dans Food Chemistry Advances a analysé l’impact combiné des probiotiques et des composés végétaux sur le microbiote intestinal et la réduction de l’inflammation. Les chercheurs ont passé en revue les preuves du rôle synergique de ces composés dans la prise en charge des maladies métaboliques, notamment les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2.
• Les personnes souffrant de troubles métaboliques et d’inflammation chronique en retirent le plus grand bénéfice : Chez les individus obèses, diabétiques de type 2, ou ayant des problèmes cardiovasculaires ou intestinaux inflammatoires, la dysbiose intestinale est un dénominateur commun. L’association de probiotiques ciblés et de bioactifs d’origine végétale a contribué à réduire l’inflammation systémique, renforcer la fonction barrière de l’intestin et rééquilibrer la diversité microbienne.
• Des souches spécifiques ont montré des effets uniques : Par exemple, Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus plantarum ont stimulé la production de mucine, une protéine qui forme un mucus protecteur, contribuant ainsi à renforcer la paroi intestinale. Pendant ce temps, Bifidobacterium longum et Bifidobacterium breve travaillent efficacement à dégrader les fibres en AGCC.
• Certains composés végétaux améliorent les performances des probiotiques : Les polyphénols présents dans le thé, les baies et le cacao favorisent la croissance des bactéries bénéfiques tout en ralentissant la prolifération des nuisibles.
Les composés végétaux et les probiotiques œuvrent également de concert pour maîtriser l’inflammation : Ils activent des cellules immunitaires qui libèrent des signaux apaisants, indiquant au système immunitaire de se calmer. Simultanément, ils aident à réduire les taux de substances chimiques pro-inflammatoires, souvent élevés chez les personnes souffrant de troubles métaboliques.
Comment stimuler votre santé intestinale pour prévenir les maladies cardiaques.
Votre intestin abrite des billions de microbes qui influencent tout, de la qualité de votre digestion à l’efficacité de votre système immunitaire et de votre métabolisme. Mais lorsque ces populations microbiennes se déséquilibrent, votre santé se dégrade à tous les niveaux.
Cependant, rétablir la santé intestinale ne se limite pas à la prise de probiotiques. Plusieurs considérations importantes permettent de favoriser l’épanouissement de votre microbiote intestinal. Je recommande de suivre ces stratégies :
1. Réparer le microbiote intestinal avant de le nourrir : Bien que les fibres soient essentielles à la santé intestinale, une consommation excessive en cas de déséquilibre ne fera qu’alimenter les microbes pathogènes, provoquant gaz, ballonnements et sous-produits toxiques comme les endotoxines. C’est le paradoxe des fibres : La substance même qui favorise un microbiote sain à long terme peut aggraver les symptômes à court terme si elle est introduite prématurément.
Si vous souffrez d’inflammation ou de prolifération bactérienne, commencez par assainir votre intestin. Éliminez les aliments ultra-transformés et privilégiez les glucides faciles à digérer, comme les fruits et le riz blanc, jusqu’à la stabilisation des symptômes. Ensuite, vous pourrez ajouter de petites quantités de glucides plus fibreux, comme les légumes-racines.
Une fois la santé intestinale rétablie, élargissez votre alimentation en ajoutant des légumes non féculents, des options amylacées (patate douce, courge), des haricots, des légumineuses et, enfin, des céréales complètes peu transformées.
2. Privilégier les bactéries productrices de butyrate : Le butyrate est un AGCC et l’un des composés curatifs les plus puissants produits par votre corps. Il nourrit les cellules de la paroi intestinale, apaise la suractivation immunitaire et réduit l’inflammation généralisée.
La production de butyrate nécessite des microbes intestinaux spécifiques, notamment Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia et Eubacterium. Ils prospèrent grâce aux fibres fermentescibles présentes dans des aliments comme les pommes de terre cuites et refroidies, les bananes vertes, les lentilles, les topinambours et l’avoine. Dès que la paroi intestinale commence à guérir, nourrir ces bactéries devient une priorité absolue.
3. Nourrir correctement Akkermansia : Bien qu’elle ne produise pas elle-même de butyrate, Akkermansia joue un rôle de soutien en maintenant et en épaississant la couche de mucus intestinal, créant un environnement idéal pour les microbes producteurs de butyrate.
Un taux élevé d’Akkermansia est fortement associé à un meilleur contrôle de la glycémie, une inflammation réduite, une fonction barrière intestinale renforcée et même une diminution de la masse grasse. Considérez-la comme une gardienne qui améliore le terrain, tandis que Faecalibacterium et d’autres génèrent le carburant. Ensemble, ils créent un microbiome stable, anti-inflammatoire et métaboliquement protecteur.
Les aliments riches en polyphénols, comme la grenade, le raisin rouge, la canneberge et le thé vert, favorisent directement la croissance d’Akkermansia. Il en va de même pour les plantes contenant de l’inuline, comme l’ail, le poireau, la racine de chicorée et l’asperge. Commencez par de petites quantités et augmentez progressivement selon votre tolérance.
4. Soutenir la santé intestinale au niveau cellulaire : Au-delà de l’ajout de fibres, il faut éliminer les facteurs qui endommagent activement l’environnement intestinal. Un coupable majeur est l’excès d’acide linoléique provenant des huiles végétales, qui perturbe la fonction mitochondriale, diminue la production d’énergie cellulaire et dégrade l’environnement intestinal. Privilégiez des graisses plus saines comme le beurre, le ghee ou le suif.
De plus, minimisez l’exposition aux perturbateurs endocriniens et aux champs électromagnétiques, car ceux-ci altèrent davantage l’énergie cellulaire et impactent négativement l’environnement anaérobie dont les bactéries bénéfiques comme Akkermansia ont besoin.
Après avoir éliminé les huiles végétales pendant au moins six mois, envisagez de prendre un supplément d’Akkermansia à libération prolongée, qui permettra à davantage de bactéries de survivre et d’atteindre votre côlon.
5. Reconstruisez des habitudes quotidiennes qui renforcent l’équilibre microbien : Manger à heures régulières, s’exposer au soleil matinal, dormir profondément, pratiquer une activité physique quotidienne suffisante et gérer le stress façonnent tous la flore intestinale et contribuent à la santé globale.
🔎Sources et Références :
- 1 World Health Organization, Cardiovascular diseases
- 2, 3 Cureus. 2025 Jun 18;17(6):e86292
- 4 J Am Heart Assoc. 2016 Jun 10;5(6):e002816
- 5 Hypertension. 2014 Oct;64(4):897-903
- 6 FASEB Journal, Volume 32, Issue S1, Experimental Biology 2018 Meeting Abstracts, April 2018, Page 924.2
- 7 Nature 2017, volume 551, pages 585-589
- 8 Food Chemistry Advances, Volume 6, March 2025, 100919