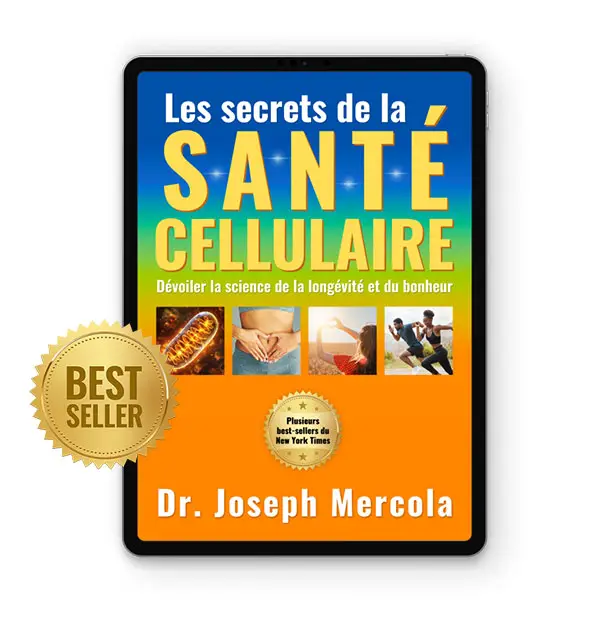📝EN BREF
- Les chances de survie d'une victime d'arrêt cardiaque diminuent de 10 % par minute écoulée.
- Seuls 42 % des témoins pratiquent la réanimation cardiopulmonaire (RCP) en public, alors que plus de 350 000 Américains subissent annuellement un arrêt cardiaque extrahospitalier.
- La RCP manuelle (100 à 120 compressions par minute, enfoncement de 5 cm) est conseillée pour le grand public, tandis que les professionnels de santé doivent utiliser le ratio 30 compressions pour 2 insufflations.
- Face à un arrêt cardiaque, les gestes immédiats sont les suivants : alerter les secours, localiser un défibrillateur automatisé externe si disponible et commencer la RCP sans délai.
- La crise cardiaque (obstruction artérielle limitant l'afflux sanguin) et l'arrêt cardiaque (dérèglement électrique provoquant une arythmie) sont deux pathologies distinctes, bien que la première puisse parfois entraîner la seconde.
🩺Par le Dr. Mercola
Un rapport du Washington Post indique que plus de 350 000 personnes subissent un arrêt cardiaque en dehors du cadre hospitalier aux États-Unis. En outre, dans neuf cas sur dix, la personne décède en l'absence d'une intervention suffisamment rapide.
L'un des moyens pour les témoins d'augmenter les chances de survie est de pratiquer la réanimation cardiopulmonaire (RCP). Cependant, cette assistance n'est pas prodiguée assez souvent. Selon les données recueillies par le rapport, seuls 42 % des témoins présents dans un lieu public ont effectué une RCP. Si vous ne savez pas comment pratiquer une RCP, vous trouverez une vidéo ci-dessous que je vous encourage vivement à visionner. Les informations qu'elle contient font la différence entre la vie et la mort.
La formation des témoins à la rcp : une différence qui sauve
Une étude publiée dans Circulation, la revue de l'American Heart Association (AHA), a examiné le lien entre le niveau de formation du public à la RCP et le taux de survie des personnes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier.
Ce terme désigne les arrêts cardiaques survenant en public. L'étude a analysé les données de nombreuses communautés, en comparant les zones bénéficiant d'une formation étendue à la RCP et celles où ces programmes étaient limités ou inexistants.
• Les bienfaits de la formation sont évidents : Les chercheurs confirment que le taux de survie des victimes s'améliore considérablement lors d'une intervention immédiate des témoins, soulignant ainsi l'importance cruciale de la sensibilisation communautaire.
Les communautés dotées de programmes de formation étendus ont enregistré une hausse notable des survies par rapport aux groupes dépourvus de tels programmes.
• La RCP immédiate améliore le pronostic : L'étude a mis en lumière de meilleurs résultats, non seulement en termes de survie, mais aussi de qualité de vie après la réanimation. Les victimes ayant bénéficié d'une RCP pratiquée rapidement par des témoins formés ont présenté moins de séquelles neurologiques graves et une probabilité bien plus élevée de retrouver une vie normale.
• Le facteur temps est déterminant : Selon l'étude, pratiquer la RCP dans les premières minutes suivant l'arrêt cardiaque influence grandement les chances de survie. Chaque minute de retard dans la mise en œuvre de la RCP réduit les chances de survie d'environ 10 %.
Une réanimation immédiate ralentit considérablement cette baisse, ce qui souligne l'importance non seulement de connaître les gestes, mais aussi d'avoir la volonté et l'assurance nécessaires pour les appliquer sans tarder.
• La formation est essentielle pour donner aux témoins les moyens d'agir : D'après les chercheurs, identifier les symptômes de l'arrêt cardiaque est primordial pour augmenter le taux de survie.
Ils précisent : « Lors d'une étude sur des premiers répondants non professionnels ayant été témoins d'un arrêt, près de la moitié n'ont pas identifié l'arrêt cardiaque. Les difficultés de reconnaissance incluent l'incapacité à détecter la cyanose (coloration bleutée du patient), à distinguer une crise convulsive potentielle et à évaluer la nature anormale de la respiration ».
• La familiarisation avec les gestes est préférable, même sans certification formelle : Bien qu'un certificat soit rassurant, les chercheurs soulignent qu'il n'est pas obligatoire.
Ils expliquent : « La formation est traditionnellement dispensée par un instructeur certifié en présentiel, pendant plusieurs heures et avec un coût pour les participants…
Cependant, des études récentes ont démontré qu'une autoformation vidéo ou par images peut être aussi efficace qu'un cours dirigé, et qu'une instruction par des pairs est équivalente à celle de professionnels de santé, ce qui pourrait accroître l'intérêt du public ».
Autres moyens de sauver des vies en dehors de la RCP
Dans l'ouvrage « Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival: A Time to Act », les auteurs ont souligné l'importance de la défibrillation précoce, le rétablissement du rythme cardiaque via un DAE, pour les victimes de mort subite en milieu extrahospitalier. Ils ont également esquissé d'autres recommandations nécessitant des transformations systémiques profondes.
• Les défibrillateurs automatisés externes (DAE) sauvent des vies : Ces appareils portables délivrent un choc électrique au cœur, « dans le but de rétablir une activité électrique et des contractions cardiaques normales ». L'étude de Circulation7 a également noté que les DAE renforçaient l'efficacité de la RCP manuelle. Les communautés bénéficiant d'un accès étendu et d'une formation combinée à la RCP et à l'utilisation du DAE ont enregistré les taux de survie les plus élevés.
• Cependant, ne comptez pas uniquement sur les DAE : Bien que leur présence dans les lieux publics garantisse une aide immédiate, ils ne constituent en aucun cas l'unique solution. Selon les auteurs, ils ne sont pas efficaces pour tous les types de rythmes en arrêt cardiaque, ni pour l'ischémie globale (manque d'afflux sanguin au cerveau). Il est donc essentiel de maîtriser la RCP et de composer immédiatement les numéros d'urgence pour couvrir tous les aspects.
• La collecte de données est primordiale : L'arrêt cardiaque est une responsabilité nationale qui incombe aux autorités, et les données recueillies contribueront à sauver des vies. D'après les auteurs :
« Des données fiables et précises sont nécessaires pour permettre aux États, aux services de santé locaux, aux services médicaux d'urgence, aux systèmes de santé et aux chercheurs d'élaborer des métriques, d'identifier des références, de réviser les supports pédagogiques et de mettre en œuvre les meilleures pratiques ».
• La mobilisation communautaire améliore la réactivité : Comme le souligne l'étude, beaucoup de personnes appréhendent de pratiquer la RCP, notamment par crainte de mal faire. Dans d'autres cas, les témoins ne connaissant pas la victime, cela les rend réticents à intervenir.
Néanmoins, l'ouvrage indique que la nature de l'arrêt cardiaque implique une « obligation sociétale pour les témoins d'être préparés et disposés à prodiguer les gestes de premiers secours avant l'arrivée des secours professionnels ». Pour y parvenir, une piste consiste à instaurer une culture positive en favorisant l'accès à la formation RCP-DAE. Les campagnes de sensibilisation augmenteront également le nombre de témoins prêts à se porter au secours d'autrui.
• Le leadership détermine la qualité des soins : Des dirigeants engagés (secteurs privé et public) ont un impact significatif sur l'aide aux victimes d'arrêt cardiaque.
« Les communautés affichant les meilleurs taux de survie et de pronostics neurologiques favorables sont généralement portées par de fortes instances civiles, médicales et sanitaires. Ces leaders rendent des comptes à leurs concitoyens en intensifiant la sensibilisation, en généralisant la formation RCP-DAE et en investissant durablement dans l'évaluation des résultats, la remontée des données et l'auto-évaluation ».
Comment Pratiquer la RCP
Si vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, agissez vite. Il est capital de débuter la RCP immédiatement pour tenter de sauver la vie de la victime. Pour le grand public, l'AHA recommande la RCP manuelle (compressions thoraciques sans insufflation). Cette méthode se concentre uniquement sur les compressions thoraciques. La vidéo ci-dessus constitue un guide facile, mais vous pouvez également suivre ces étapes :
1. Placez le talon d'une main au centre du thorax de la victime et l'autre main par-dessus.
2. Effectuez les compressions thoraciques à un rythme de 100 à 120 par minute. Pour garder un rythme régulier, sachez que la RCP se pratique approximativement au tempo de la chanson « Stayin' Alive » des Bee Gees, soit 100 battements par minute.
3. Appuyez fermement et rapidement au centre de la poitrine pour l'enfoncer d'environ 5 centimètres chez un adulte moyen.
4. Ne vous interrompez pas ; réduisez au minimum toute pause pour maintenir une circulation sanguine continue.
5. Évitez de vous appuyer sur le thorax entre les compressions pour lui permettre de revenir complètement à sa position initiale.
• Faites appeler les secours : Pendant que vous pratiquez la RCP, demandez à une autre personne de composer le 911 (ou le 112 en Europe) et de suivre les consignes de l'opérateur. N'attendez pas et n'hésitez pas, le temps est critique lors d'un incident cardiaque. Si vous êtes seul, composez vous-même le numéro d'urgence en mode haut-parleur pour écouter les instructions tout en poursuivant la RCP.
• Faites rechercher un DAE : Demandez aux autres témoins de localiser un défibrillateur automatisé externe. La loi impose l'installation de ces appareils dans les lieux publics tels que les écoles, les salles de sport, les casinos et les terrains de golf (selon la réglementation locale).
• La RCP pour les professionnels de santé est différente : Si vous êtes formé ou travaillez en milieu hospitalier, l'AHA recommande la RCP traditionnelle avec un ratio de 30 compressions pour 2 insufflations, en répétant ce cycle.
• N'ayez pas peur de secourir une personne en détresse : Il est naturel d'hésiter, notamment sous le coup de la peur ou de la stupeur, surtout si vous n'avez jamais été confronté à un arrêt cardiaque en public. Mais rappelez-vous qu'à ce stade, la personne est cliniquement morte et que son état ne peut pas empirer.
La RCP manuelle pratiquée par un témoin et l'arrivée rapide d'un DAE augmenteront sensiblement les chances de survie et de rétablissement. De plus, la loi protège en général tout citoyen portant assistance de bonne foi à une personne en péril.
Arrêt cardiaque et crise cardiaque : quelle est la différence ?
Bien que souvent confondues, l'arrêt cardiaque et la crise cardiaque sont deux pathologies distinctes. Néanmoins, un lien existe.
•La crise cardiaque implique une obstruction : Elle survient lorsqu'une artère cesse d'irriguer le cœur, que l'obstruction soit partielle ou totale. Le muscle cardiaque affecté commence alors à mourir par manque d'oxygène.
Cependant, la RCP n'est nécessaire lors d'une crise cardiaque que si la personne est inconsciente. Si la victime est consciente, aidez-la à s'asseoir, à se reposer et à rester calme en attendant les secours.
• L'aspirine peut être utile : Elle fluidifie le sang, prévient la formation de caillots et améliore la circulation sanguine vers le cœur. Mais ne l'administrez que si vous êtes certain que le patient n'y est pas allergique et qu'aucun autre médicament ne contre-indique sa prise.
• L'arrêt cardiaque est un problème d'impulsion électrique : Il s'agit d'une défaillance du système électrique du cœur, provoquant une arythmie qui entraîne un arrêt de la circulation sanguine vers le cerveau, les poumons et les autres organes vitaux. Cela étant, une crise cardiaque n'évolue pas systématiquement vers un arrêt cardiaque. Néanmoins, selon l'AHA, la crise cardiaque est une cause fréquente d'arrêt cardiaque.
Autres stratégies à connaître en cas de crise cardiaque
Outre la RCP, deux autres stratégies peuvent augmenter les chances de survie, particulièrement après une crise cardiaque : le bleu de méthylène et la mélatonine.
• Le bleu de méthylène aide à protéger votre cœur : Ce composé, précurseur de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine, aide à réduire la lésion de reperfusion chez les survivants d'une crise cardiaque . Ce type de lésion affecte les tissus et organes lorsque la circulation sanguine est rétablie après une période de privation d'oxygène.
• Recommandations de dosage pour le bleu de méthylène : Une administration correcte est essentielle pour éviter le surdosage. Je recommande l'utilisation d'une microcuillère pour mesurer avec précision un produit de qualité pharmaceutique, c'est-à-dire pur à plus de 99 %. Mesurez la dose avec une microcuillère, une dose inférieure à 50 milligrammes peut déjà sauver une vie.
Pour des traitements au long cours (prévention de la démence, soins post-AVC, amélioration cognitive, optimisation de la santé), suivez une dose de 0,5 à 1 mg par kilogramme de poids corporel.
•La mélatonine n'est pas qu'une aide au sommeil : Je recommande de conserver de la mélatonine à 10 milligrammes en forme sublinguale. Cette hormone contribue à réduire la lésion de reperfusion si elle est administrée après une crise cardiaque. De même, le bleu de méthylène doit être donné immédiatement, dans les minutes suivant la crise, pour agir dans le délai critique.
• N'oubliez pas de prendre soin de votre cœur : Le bleu de méthylène et la mélatonine ont leurs limites dans une optique de sauvetage. L'essentiel est de traiter la cause profonde : veiller à la santé de votre cœur.
Pour commencer, je vous conseille de réduire votre consommation d'huiles végétales riches en acide linoléique (AL) dont l'excès favorise les maladies chroniques (obésité, diabète, inflammation), facteur majeur de cardiopathie. À ce titre, je recommande également d'optimiser votre santé intestinale, un microbiote déséquilibré participant à l'inflammation.
Pour des conseils plus détaillés, lisez « Infarctus ou arrêt cardiaque : quelle est la différence ? ».
Questions Fréquentes (FAQ) sur l'Importance de la RCP lors d'un Arrêt Cardiaque
Q : Pourquoi la formation à la RCP est-elle importante ?
R : Elle améliore significativement les chances de survie des victimes d'arrêt cardiaque extrahospitalier. Les communautés bien formées affichent de meilleurs taux de survie, avec des séquelles neurologiques moindres et une meilleure qualité de vie après le rétablissement.
Q : À quelle rapidité la RCP doit-elle être pratiquée après un arrêt cardiaque ?
R : Une RCP immédiate est cruciale, idéalement dans les premières minutes. Les chances de survie diminuent d'environ 10 % par minute de retard. Une action rapide augmente considérablement les chances de survie et de récupération.
Q : Les témoins doivent-ils pratiquer seulement la RCP ou aussi utiliser un DAE ?
R : Combiner la RCP et le DAE offre les meilleurs taux de survie. Le DAE rétablit le rythme cardiaque normal et renforce l'efficacité de la RCP. Une formation double RCP-DAE est fortement conseillée.
Q : Une formation officielle est-elle nécessaire pour intervenir lors d'une urgence ?
R : Aucune certification formelle n'est requise pour porter secours. Même une initiation basique, autodidacte ou vidéo, permet efficacement à un témoin de sauver des vies. La RCP manuelle (compressions seules) est recommandée pour le grand public.
Q : Quelle est la différence entre une crise cardiaque et un arrêt cardiaque ?
R : La crise cardiaque est provoquée par une obstruction bloquant l'afflux sanguin vers le cœur, tandis que l'arrêt cardiaque résulte d'un problème électrique perturbant le rythme cardiaque. Une crise cardiaque peut entraîner un arrêt cardiaque, mais ce sont deux pathologies distinctes exigeant des réponses immédiates différentes.
🔎Sources et Références :
- 1, 2, 11 The Washington Post, April 28, 2025
- 3, 4, 5, 7 Circulation Volume 145, Issue 17, March 21, 2022
- 6, 8, 9 Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival: A Time to Act
- 10 AHA, What Is CPR?
- 12, 13 Mayo Clinic, “Heart Attack”
- 14, 15 AHA, “Heart Attack and Sudden Cardiac Arrest Differences”
- 16 Rumble, Children’s Health Defense, Good Morning CHD, Episode 82 July 22, 2022, 4:58