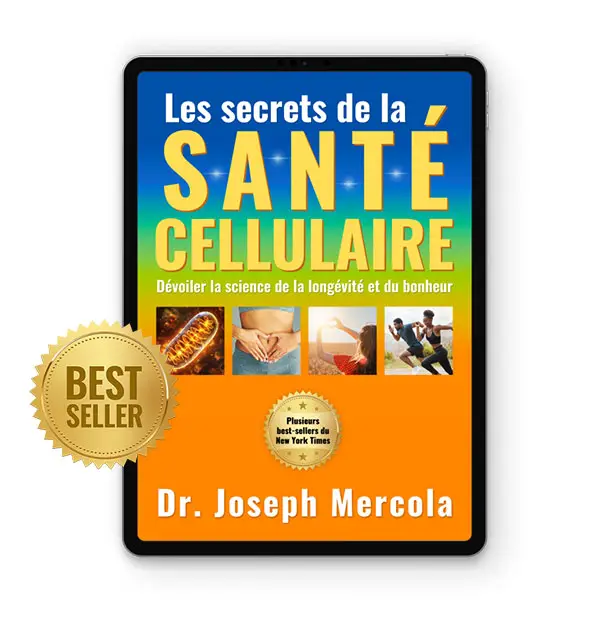📝EN BREF
- Aux États-Unis, près de 15 % des adultes ont un apport alimentaire en zinc insuffisant, les exposant à un risque de dérèglement immunitaire, de déséquilibre hormonal et de cicatrisation ralentie.
- Les phytates présents dans les céréales et les légumineuses inhibent l’assimilation du zinc. Les régimes végétaliens constituent ainsi une cause méconnue de carence, même lorsque l’apport semble convenable.
- Les symptômes d’un faible taux de zinc, tels que les rhumes à , la chute des cheveux ou la perte du goût et de l’odorat, sont fréquemment mal diagnostiqués ou négligés, car ils ressemblent à d’autres affections.
- Les compléments de zinc sont utiles durant une convalescence, mais des doses élevées, excédant 40 mg par jour, entraînent des effets secondaires, notamment une carence en cuivre et des lésions nerveuses.
- Pour couvrir vos besoins, privilégiez les sources alimentaires, en particulier les huîtres, le bœuf nourri à l’herbe, le crabe et les produits laitiers, dont le zinc est bien mieux assimilé que celui des sources végétales ou enrichies.
🩺Par le Dr. Mercola
Votre organisme ne requiert pas de grandes quantités de zinc, mais sans un apport quotidien régulier, votre santé se dégrade insidieusement. Cet oligo-élément intervient dans la protection immunitaire, la réparation des tissus, l’équilibre hormonal et la croissance cellulaire. Pourtant, l’organisme ne dispose d’aucune réserve à long terme. Il est donc impératif d’en consommer quotidiennement via l’alimentation, sous peine de souffrir d’une carence latente.
Le problème réside dans le fait que la majorité des personnes ignorent la facilité avec laquelle cette carence peut s’installer. L’assimilation du zinc ne dépend pas seulement des aliments ingérés, mais aussi de la capacité d’absorption de l’organisme. Des facteurs courants, tels que les régimes végétaliens, les troubles digestifs ou le stress chronique, entravent ce processus. Même un régime alimentaire a priori équilibré fournit rarement suffisamment de zinc biodisponible pour assurer des fonctions essentielles, comme la cicatrisation, la production de testostérone ou la défense immunitaire.
Les symptômes d’une carence en zinc se manifestent souvent de façon détournée. Une fatigue persistante, des rhumes fréquents, une chevelure clairsemée, une perte d’appétit ou une convalescence prolongée semblent sans lien, mais ils signalent tous un déséquilibre profond du fonctionnement cellulaire.
Pour comprendre l’impact concret de cette carence et sa prévalence insoupçonnée, examinons les conclusions de Harvard Health Publishing sur le zinc, ses sources alimentaires et son importance capitale.
La carence en zinc passe souvent inaperçue jusqu’à ce que des dommages apparaissent
Un article publié par Harvard Health Publishing souligne le rôle du zinc dans plusieurs processus physiologiques fondamentaux, allant de la vitesse de cicatrisation à l’acuité du goût et de l’odorat. Son action ne se limite pas au traitement du rhume. Le zinc est un acteur polyvalent, indispensable à la formation osseuse, à la production hormonale, à la reproduction et même au développement fœtal.
• La carence en zinc est plus fréquente qu’il n’y paraît, notamment chez les personnes souffrant de troubles intestinaux ou suivant des régimes restrictifs : Teresa Fung, diététicienne-nutritionniste et professeure associée à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, rappelle que l’organisme ne peut synthétiser le zinc. Il doit donc être impérativement apporté par l’alimentation. Si la carence avérée est rare aux États-Unis, l’insuffisance modérée est bien plus répandue et n’est souvent détectée qu’à l’apparition de symptômes multiples.
• Les symptômes de faibles taux de zinc miment souvent d’autres pathologies, ce qui retarde le diagnostic : Certains patients observent une cicatrisation ralentie, des infections récurrentes, des éruptions cutanées ou une alopécie. Ces signes d’alerte, étant peu spécifiques, sont fréquemment attribués à d’autres causes. La perte du goût et de l’odorat, particulièrement marquée après une maladie, est également liée à un apport insuffisant en zinc, et pas uniquement aux virus ou au vieillissement.
• Une carence, même légère, affecte l’équilibre hormonal et la santé reproductive : Le zinc intervient en effet dans la synthèse de l’insuline et de la testostérone. Ainsi, les hommes présentant un taux sous-optimal connaissent souvent une baisse de la fertilité ou de la libido. De même, les personnes sujettes à un dérèglement glycémique deviennent plus résistantes à l’insuline avec le temps.
• Les enfants et adolescents carencés encourent des risques spécifiques : Un faible taux de zinc augmente la probabilité de retards de croissance, d’infections fréquentes et de troubles digestifs, tels que la diarrhée. Harvard souligne que ces effets ne sont pas toujours imputés à un déséquilibre minéral. Pourtant, traiter la cause fondamentale, à savoir la carence en zinc, produit une amélioration notable.
• La grossesse accroît les besoins en zinc, et une carence impacte le fœtus : Son développement repose sur le zinc pour la réplication de l’ADN, la croissance cellulaire et la fonction immunitaire. C’est pourquoi l’Apport Nutritionnel Conseillé (ANC) en zinc s’élève à 11 milligrammes (mg) par jour pour les femmes enceintes et à 12 mg pour les femmes allaitantes.
Une carence en zinc méconnue touche plus de 15 % des adultes
Le Bureau des Compléments Alimentaires des National Institutes of Health (NIH) met en lumière une lacune nutritionnelle silencieuse au sein de la population américaine. Selon leur fiche d’information détaillée sur le zinc, près de 15 % des adultes américains n’atteignent pas l’Apport Moyen Estimatif, et ce, malgré l’accès aux aliments enrichis et aux compléments. Ce phénomène ne se limite pas aux personnes présentant des problèmes de santé avérés. Même les individus bien nourris peuvent en souffrir à leur insu, particulièrement les seniors, les adolescents, les femmes enceintes et les personnes adoptant un régime majoritairement végétalien.
• Le zinc alimentaire n’est pas toujours assimilé de la même manière, ce qui change la donne : Les NIH indiquent que la capacité d’absorption de l’organisme dépend étroitement des autres aliments consommés. Les phytates, des composés naturellement présents dans les céréales, les haricots, les graines et les noix, se lient au zinc dans le tube digestif et en bloquent l’assimilation. Ainsi, un repas végétarien ou végétalien affichant une « teneur élevée en zinc » sur le papier fournit en réalité très peu de zinc utilisable à l’organisme.
• Le taux de zinc fluctue sous l’effet du stress, de l’inflammation et même de l’heure de la journée : Les analyses sanguines utilisées pour diagnostiquer une carence manquent parfois de fiabilité. Ce taux varie en fonction des cycles hormonaux, de la prise alimentaire récente et de la présence d’une maladie ou d’une perte de poids. Il est donc aisé de passer à côté d’une réelle insuffisance sans une évaluation clinique des symptômes et des facteurs de risque, tels qu’une mauvaise absorption intestinale, la consommation d’alcool ou l’inflammation chronique.
• Le zinc exerce des effets mesurables sur de nombreuses fonctions, de la vision à la glycémie : Chez les personnes diabétiques de type 2, un faible taux de zinc est associé à une détérioration de la fonction insulinique et à l’inflammation. Les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge tirent également profit d’une supplémentation, qui ralentit l’évolution de la pathologie. Dans les pays à faible revenu, la supplémentation en zinc réduit la durée des épisodes diarrhéiques de plus d’une journée chez l’enfant.
D’un point de vue biologique, le zinc régule des centaines d’enzymes qui actionnent la machinerie cellulaire. Ces enzymes aident l’organisme à générer de nouvelles cellules, à réparer les lésions et à soutenir la fonction immunitaire. En cas de carence, la réplication de l’ADN, la cicatrisation et la signalisation immunitaire se dérèglent, engendrant une multitude de symptômes en apparence sans lien.
• Le zinc est principalement stocké dans les muscles et les os, et il est recyclé quotidiennement via le système digestif : Les pertes dues à la sueur, à l’urine et au renouvellement cutané rendent indispensable un apport journalier régulier. Cet apport doit provenir de l’alimentation ou, à défaut, d’une supplémentation, si la qualité nutritionnelle est insuffisante ou si l’absorption est compromise.
• Un excès de zinc perturbe le métabolisme du cuivre et du magnésium, générant de nouveaux troubles : Des doses complémentaires élevées, supérieures à 40 mg par jour, sont associées à des nausées, une immunosuppression et une carence en cuivre. Une surconsommation prolongée a même été reliée à des symptômes neurologiques et à une anémie, en particulier chez les utilisateurs de crèmes dentaires contenant du zinc.
Les pastilles de zinc réduisent la durée du rhume
La Mayo Clinic a rapporté l’efficacité du zinc pour écourter la durée d’un rhume, favoriser la cicatrisation et renforcer l’immunité. La prise de zinc réduit la durée des rhumes de 33 % et en atténue la sévérité.
• Le timing est important en cas de rhume : le zinc est plus efficace si vous agissez rapidement : Les pastilles ou le sirop de zinc ne raccourcissent la durée d’un rhume que si vous les prenez dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes. C’est parce que le minéral interagit directement avec les virus présents dans votre gorge et vos voies nasales. Une fois l’infection propagée en profondeur, l’effet des pastilles devient négligeable.
• Tous les produits à base de zinc ne sont pas sûrs : Les sprays nasaux, en particulier, ont été associés à une perte irréversible de l’odorat. La Mayo Clinic insiste sur l’importance d’éviter tout produit zincué appliqué dans le nez, précisant que « l’odorat peut ne jamais revenir » chez certains utilisateurs.
• La cicatrisation s’améliore lors de la correction d’une carence : Le zinc participant à la régénération tissulaire, les patients souffrant d’ulcères cutanés ou de plaies à cicatrisation lente tirent souvent profit d’une supplémentation, surtout si leur taux sanguin est bas. Ce constat est particulièrement vérifié chez les personnes âgées et les individus présentant une mauvaise absorption des nutriments. Les patients carencés observent fréquemment une amélioration notable.
• Les effets secondaires des compléments sont plus fréquents qu’on ne le pense : Une prise orale peut provoquer des nausées, des céphalées et des malaises gastriques. Une utilisation prolongée à fortes doses accroît le risque de carence en cuivre et de troubles neurologiques, tels que des paresthésies. La Mayo Clinic met en garde contre le dépassement de 40 mg par jour sans suivi médical.
• Les interactions médicamenteuses peuvent neutraliser l’effet des antibiotiques ou des traitements contre l’arthrite : Le zinc altère l’absorption de certains médicaments, notamment les antibiotiques de type tétracycline ou les antirhumatismaux comme la pénicillamine. La Mayo Clinic recommande de prendre ces médicaments au moins deux heures avant ou quatre à six heures après la prise de zinc, afin d’éviter toute interaction.
Comment s’assurer un apport suffisant en zinc
Si vous souffrez de rhumes à , de cicatrisation ralentie ou d’une fatigue inexpliquée, un déficit en zinc pourrait en être la cause. Mais la solution ne réside pas uniquement dans la prise d’un comprimé, surtout si votre alimentation ou votre digestion pose problème. Il s’agit plutôt de rétablir l’équilibre en traitant la cause profonde de la carence ou de la mauvaise absorption. Concrètement, cela implique d’optimiser son alimentation, de recourir judicieusement aux compléments et d’éviter les pièges courants qui entravent l’action du zinc. Voici comment garantir à votre organisme un apport adéquat.
1. Privilégiez les sources alimentaires naturelles et biodisponibles : Les aliments d’origine animale, qui fournissent un zinc hautement assimilable, sont à favoriser. Les huîtres détiennent la teneur en zinc la plus élevée, suivies du bœuf nourri à l’herbe, du crabe et des fromages type cheddar. Ces sources surpassent nettement les options végétales, car elles sont dépourvues de phytates, ces inhibiteurs de l’absorption.
2. Limitez la consommation d’aliments qui « captent » le zinc : Si votre alimentation est riche en céréales complètes ou en légumineuses, soyez conscient que leurs phytates se lient au zinc dans l’intestin. Le trempage, la fermentation ou la germination atténuent cet effet, mais la biodisponibilité reste inférieure à celle de la viande. Les régimes végétariens ou végétaliens nécessitent un apport quotidien plus important pour un bénéfice équivalent.
3. Favorisez le zinc alimentaire plutôt que les compléments : Une supplémentation, à faible dose, peut se justifier en cas de régime végétalien, de grossesse, de convalescence, de diabète ou de pathologie intestinale, mais elle ne doit pas se substituer à l’alimentation. Un dosage supérieur à 40 mg par jour risque de provoquer des effets secondaires, notamment une carence en cuivre et des lésions nerveuses. Idéalement, je recommande de couvrir vos besoins quotidiens par une alimentation variée.
4. Respectez le moment de prise pour optimiser l’assimilation : Le zinc entre en compétition avec d’autres minéraux et médicaments lors de l’absorption. Si vous prenez des antibiotiques, des antirhumatismaux ou des compléments de calcium, espacez la prise de zinc de plusieurs heures.
5. Évitez les sprays nasaux à base de zinc : Ces produits ont provoqué une perte définitive de l’odorat chez certains utilisateurs. Pour écourter un rhume, optez pour des pastilles ou un sirop, à débuter dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes.
FAQ sur le zinc
Q : Quels sont les signes d’une carence en zinc ?
R : Les signes courants incluent une cicatrisation ralentie, des rhumes fréquents, une chute de cheveux, une perte du goût ou de l’odorat et des éruptions cutanées. Ces symptômes, étant peu spécifiques, sont souvent attribués à d’autres troubles, ce qui explique que la carence passe souvent inaperçue.
Q : Quelles sont les meilleures sources alimentaires de zinc ?
R : Les formes les plus biodisponibles proviennent des aliments d’origine animale, tels que les huîtres, le bœuf nourri à l’herbe et les produits laitiers. Bien que les céréales complètes et les légumineuses contiennent du zinc, leurs phytates en inhibent l’absorption, ce qui les rend moins efficaces pour augmenter le taux sanguin.
Q : Dois-je prendre un complément de zinc ?
R : Uniquement si vous appartenez à un groupe à risque, comme les femmes enceintes, les personnes souffrant de troubles digestifs ou en convalescence, ou si vous présentez des signes évidents de carence. Si vous vous supplémentez, ne dépassez pas 40 mg par jour pour éviter les effets secondaires, tels que la carence en cuivre et les nausées.
Q : Quelle est la méthode la plus sûre pour utiliser le zinc contre le rhume ?
R : Initiez la prise de pastilles ou de sirop dans les 24 premières heures suivant l’apparition des symptômes pour en réduire la durée. Proscrivez les sprays nasaux, associés à une perte irréversible de l’odorat.
Q : Comment améliorer l’absorption du zinc dans le cadre d’un régime végétalien ?
R : Si votre alimentation est majoritairement végétale, envisagez de tremper, de germer ou de fermenter les céréales et légumineuses pour réduire leur teneur en phytates. Vous devrez également consommer plus de zinc que l’apport standard pour satisfaire les besoins de votre organisme.
🔎Sources et Références :
- 1 Harvard Health Publishing April 7, 2025
- 2 National Institutes of Health, Zinc
- 3 The Journal of Physiological Sciences January 2018, Volume 68, Issue 1, Pages 19-31
- 4 Int J Mol Sci. 2020 Jul 15;21(14):4994
- 5 PLoS One. 2018 Dec 5;13(12):e0207701
- 6 JRSM Open. 2017 May 2;8(5):2054270417694291
- 7, 8 Mayo Clinic, Zinc