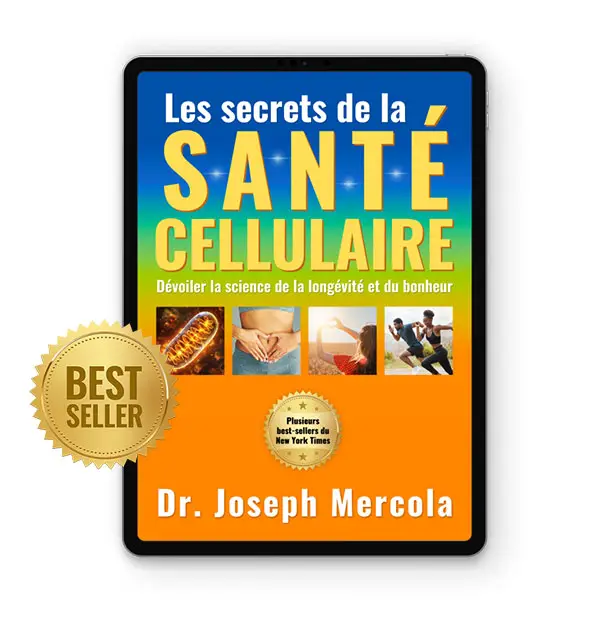📝EN BREF
- La maladie d’Alzheimer affecte mémoire et cognition, avec plus de 150 millions de cas attendus d’ici 2050. Elle est principalement causée par l’inflammation, le stress oxydatif et les dysfonctionnements intestin-cerveau.
- La consommation de kéfir améliore significativement mémoire et cognition en réduisant plaques amyloïdes, enchevêtrements de tau et marqueurs inflammatoires, tout en protégeant les neurones.
- L’acide pentadécanoïque (C15:0), présent dans les produits laitiers de pâturage comme le kéfir, renforce les membranes cellulaires, protège les mitochondries et limite les effets nocifs de l’acide linoléique.
- L’excès de fer dans le cerveau accélère la maladie d’Alzheimer via le stress oxydatif et la ferroptose, les dons sanguins réguliers réduisent ce surdosage.
- Des stratégies quotidiennes telles que l’optimisation des bactéries intestinales bénéfiques, l’élimination des huiles végétales de votre alimentation, et l’évitement du gluten offrent une protection contre le déclin cognitif et la neurodégénérescence.
🩺Par le Dr. Mercola
La maladie d’Alzheimer (MA) est un trouble neurologique progressif qui érode progressivement la mémoire, le langage, la prise de décision et le comportement. Au fil du temps, elle prive l’individu de son autonomie et de son identité. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle représente 60 à 70 % de tous les cas de démence. D’ici 2050, le nombre de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer devrait dépasser 150 millions dans le monde.
La maladie débute généralement par de simples oublis, comme égarer ses clés, répéter les mêmes questions ou perdre le fil d’une conversation. Mais à mesure qu’elle progresse, elle entraîne désorientation, sautes d’humeur, changements de personnalité, et finalement une perte totale d’autonomie. L’inflammation, le stress oxydatif, les mitochondries endommagées et les troubles intestin-cerveau jouent tous un rôle dans son développement.
Cette compréhension a conduit les chercheurs à explorer de nouvelles stratégies visant à traiter les causes profondes de cette affection. Par exemple, une revue systématique récente publiée dans le journal Brain Behavior and Immunity Integrative a révélé que le kéfir, une boisson laitière fermentée riche en probiotiques, pourrait constituer un outil prometteur pour soutenir la prise en charge de la maladie d’Alzheimer.
Comment le kéfir aide à prévenir et ralentir la maladie d’Alzheimer
L’étude présentée a examiné le potentiel du kéfir en tant que traitement complémentaire de la maladie d’Alzheimer. La revue a inclus sept études portant sur des invertébrés, des rongeurs et des humains, et s’est concentrée sur les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices du kéfir. Voici les principales observations :
• Le kéfir réduit les plaques amyloïdes et les enchevêtrements tau : Les chercheurs ont observé que le kéfir diminuait l’accumulation des protéines bêta-amyloïdes, considérées comme un marqueur de la maladie d’Alzheimer (même si des rétractations scientifiques récentes concernant la manipulation de données ont soulevé des questions sur l’impact de cette protéine). Des réductions des protéines tau ont également été notées. Ces deux protéines sont impliquées dans le déclin cognitif et la mort neuronale observés dans la maladie d’Alzheimer.
• Amélioration de la fonction cognitive à travers les espèces : Des progrès en mémoire et en comportement ont été observés chez les rongeurs, tandis que des modèles de mouches drosophiles ont montré une survie accrue et une meilleure coordination motrice. La supplémentation en kéfir a entraîné une amélioration de 28 % de la cognition globale et une augmentation de 66 % de la mémoire immédiate, la mémoire différée s’améliorant de 62 %.
• Le kéfir réduit le stress oxydatif et préserve les neurones : Les marqueurs de dommages oxydatifs, tels que les ROS, la nitrotyrosine et l’iNOS, ont été réduits après traitement par le kéfir chez les rongeurs. Les neurones dans des régions telles que l’hippocampe et le cortex ont également été mieux préservés.
• Inflammation et dommages neuronaux diminués : Le kéfir a réduit les marqueurs inflammatoires tels que NF-κB et caspase-3, liés à l’apoptose neuronale. Il a également inhibé des voies inflammatoires clés (TLR4, MYD88, NLRP3) et réduit les cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-8, IL-12).
• Amélioration de l’équilibre immunitaire et de la santé intestinale : Les études ont montré que le kéfir modulait les réponses immunitaires et restaurait l’intégrité de la muqueuse intestinale.
• Le kéfir améliore la signalisation de l’insuline dans le cerveau : Certains modèles de rongeurs ont montré une augmentation de l’enzyme de dégradation de l’insuline (IDE) dans l’hippocampe et une meilleure régulation des récepteurs de l’insuline. Ces modifications soutiennent la fonction neuronale et réduisent l’accumulation d’amyloïde.
• Les composés bioactifs uniques du kéfir expliquent ses effets : Le kéfir contient des peptides qui bloquent l’acétylcholinestérase (le même mécanisme utilisé par de nombreux médicaments contre la MA) et réduisent les dommages oxydatifs aux protéines. Le kéfiran, un glucide complexe présent dans le kéfir, module également l’inflammation et le microbiote intestinal. Ces caractéristiques font du kéfir un agent neuroprotecteur prometteur.
• Une utilisation à long terme pourrait maintenir la protection cognitive : Au-delà des études à court terme, la capacité du kéfir à réguler les neurotransmetteurs (dopamine, sérotonine, acétylcholine et GABA) et à favoriser le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) suggère des bénéfices continus avec un usage prolongé.
La supplémentation en kéfir améliore les symptômes de la maladie d’Alzheimer
Une des études incluses dans la revue présentée est un essai clinique publié dans Oxidative Medicine and Cellular Longevity, qui a évalué les effets de 90 jours de consommation de lait fermenté au kéfir chez des patients âgés atteints de la maladie d’Alzheimer. Cet essai a fourni un aperçu détaillé de l’impact du kéfir sur les principaux moteurs de la neurodégénérescence.
• L’inflammation a fortement diminué : Les niveaux sériques de cytokines pro-inflammatoires ont chuté significativement après la supplémentation en kéfir. Les ratios de cytokines se sont également améliorés, indiquant un passage d’une réponse pro-inflammatoire à une réponse immunitaire plus équilibrée, ce qui réduit l’accumulation d’amyloïde et protège le tissu cérébral.
• Le stress oxydatif a été supprimé : Les niveaux de superoxyde, de peroxyde d’hydrogène et de peroxynitrite ont diminué de 30 %, tandis que la biodisponibilité de l’oxyde nitrique a doublé. Cela améliore la circulation sanguine et protège les neurones des dommages oxydatifs.
• L’apoptose et les dommages à l’ADN ont été inversés : La fragmentation de l’ADN est passée de 15 % à 5 %, et le PARP-1 clivé (marqueur de la mort cellulaire programmée) a diminué de plus de 75 %. Le taux de cellules apoptotiques a presque été réduit de moitié, tandis que la population de cellules saines a augmenté, reflétant une meilleure stabilité tissulaire. Ces changements suggèrent que le kéfir ne ralentit pas seulement les dommages cellulaires, mais favorise également la réparation et la survie au niveau des tissus.
• La signalisation p53 a été activée : L’expression de p53 a triplé après la supplémentation. Cette protéine régulatrice majeure est essentielle pour la réparation de l’ADN, la protection mitochondriale et la suppression tumorale, et son activation contribue à expliquer l’impact neuroprotecteur étendu du kéfir.
• Un effet synbiotique complexe : Le kéfir utilisé dans l’étude contenait à la fois des bactéries bénéfiques et des levures. Ses composés bioactifs, tels que peptides, polysaccharides et vitamines, ont agi en synergie pour moduler l’axe intestin-cerveau, renforcer la capacité antioxydante et activer des voies neuroprotectrices comme GABA et BDNF.
• Sûr et accessible : Le kéfir a été bien toléré, sans effets indésirables rapportés. Bien qu’il s’agisse d’un essai non contrôlé, l’ampleur des changements biologiques observés justifie de futurs essais randomisés et soutient l’utilisation du kéfir comme intervention naturelle à faible risque dans la prise en charge précoce de la maladie d’Alzheimer.
Le kéfir contient du C15:0, un acide gras essentiel qui protège le cerveau
Le kéfir n’est pas seulement riche en probiotiques et peptides bioactifs. En tant que produit laitier, il contient également de l’acide pentadécanoïque (C15:0), un acide gras saturé essentiel reconnu pour son rôle dans la prévention de la dégradation cellulaire, l’inversion des dommages métaboliques et la protection du cerveau contre la neurodégénérescence.
• Le C15:0 est essentiel à la résilience cellulaire : Cet acide gras saturé à chaîne impaire s’intègre dans les membranes cellulaires, les renforçant et les rendant plus résistantes au stress oxydatif. Contrairement aux acides gras polyinsaturés (AGPI), qui fragilisent les membranes, le C15:0 les stabilise. Cela est particulièrement important pour les cellules cérébrales, très vulnérables à l’oxydation et à la dégradation mitochondriale dans la maladie d’Alzheimer.
• Le C15:0 aide à remplacer l’acide linoléique (LA) dans les tissus : Les recherches montrent que les personnes atteintes d’Alzheimer présentent des niveaux élevés de métabolites oxydés de l’acide linoléique (OXLAM) dans le plasma. Ces sous-produits toxiques favorisent l’inflammation systémique, altèrent la fonction mitochondriale et contribuent à la ferroptose, une forme de mort cellulaire dépendante du fer associée à la neurodégénérescence.
Le C15:0 limite ce processus en remplaçant le LA dans les membranes cellulaires, réduisant la peroxydation lipidique et stabilisant les structures cellulaires avant que les dommages ne s’installent. J'ai soumis un article scientifique détaillant ce mécanisme et son importance pour la détoxification à long terme de l'acide linoléique (AL), un sujet sur lequel je partagerai davantage d'informations dans un avenir proche.
• Cet acide gras est essentiel, mais la plupart des personnes n’en consomment pas suffisamment : Le C15:0 répond à tous les critères d’un acide gras essentiel. Le corps n’en produit pas en quantité significative, et sa carence est désormais associée à un ensemble de problèmes regroupés sous le terme de « syndrome de fragilité cellulaire ». Cela inclut des globules rouges fragiles, l’anémie et le syndrome de surcharge en fer dysmétabolique (DIOS), caractérisé par un excès de stockage du fer, notamment dans le foie.
Le DIOS augmente le risque de ferroptose, une forme destructrice de mort cellulaire déclenchée par le fer et la peroxydation lipidique, ciblant les membranes mitochondriales et interrompant la production d’énergie. Ce processus peut contribuer à l’aggravation de la stéatose hépatique, de la stéato-hépatite et au déclin métabolique plus large.
• Le C15:0 protège les mitochondries et ralentit la neurodégénérescence : Dans le cerveau, le C15:0 protège les neurones contre la ferroptose. Il préserve la production d’énergie, soutient la longévité cellulaire, protège contre le vieillissement et les dommages tissulaires, et contribue au maintien des fonctions cognitives avec l’âge.
• Le kéfir issu de vaches nourries à l’herbe est une source clé de C15:0 : L’agriculture moderne a considérablement réduit le C15:0 dans les produits laitiers en favorisant l’alimentation des bovins avec des céréales. Le kéfir produit à partir de lait de vaches nourries à l’herbe conserve davantage de cet acide gras vital. Une autre source intéressante est une portion de fromage issu de pâturage ou une cuillère à soupe de beurre, apportant chacune 100 à 130 mg de C15:0, quantité suffisante pour soutenir la réparation cellulaire et contrer les dommages liés à l’acide linoléique au fil du temps.
Pour approfondir le rôle du C15:0 et comprendre pourquoi cet acide gras peut être essentiel, consultez «Une étude sur les dauphins révèle une « nouvelle graisse » qui empêche les globules rouges de devenir fragiles».
Surcharge en fer : un accélérateur silencieux de la maladie d’Alzheimer
Un autre facteur contribuant au développement de la maladie d’Alzheimer est l’excès de fer. Bien que le fer soit indispensable au fonctionnement normal des cellules, son excès entraîne une cascade dangereuse de stress oxydatif, d’inflammation et de dégénérescence neuronale. Une revue publiée en 2024 dans Aging Medicine a examiné comment l’accumulation de fer dans une région clé du cerveau favorise le développement et la progression de la maladie d’Alzheimer.
• Le précuneus stocke l’excès de fer dès les premiers stades : Le précuneus est la zone cérébrale responsable de la mémoire, de l’attention et de la conscience de soi, et est particulièrement vulnérable aux dommages oxydatifs induits par le fer . Plusieurs études d’imagerie montrent que les individus présentant un déficit cognitif léger et les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont des niveaux de fer significativement plus élevés dans le précuneus.
• La surcharge en fer favorise la pathologie amyloïde et tau : La revue a confirmé que des niveaux élevés de fer accélèrent l’agrégation des plaques amyloïdes et des enchevêtrements de protéines tau. Ces deux éléments contribuent directement à la mort neuronale et au déclin cognitif.
• Le fer perturbe les mitochondries et augmente le stress oxydatif : L’accumulation de fer entraîne une production accrue d'ERO, qui endommage les structures cellulaires et altère le fonctionnement mitochondrial. Cela affaiblit l’apport énergétique du cerveau et accélère la mort neuronale.
• La ferroptose est la principale voie de mort cellulaire : Dans le précuneus, la surcharge en fer déclenche la ferroptose. Contrairement à l’apoptose, ce processus provoque une défaillance mitochondriale catastrophique et est plus difficile à inverser.
Stratégies complémentaires pour prévenir la maladie d’Alzheimer
La prévention de la maladie d’Alzheimer nécessite plus qu’une seule intervention. Elle repose sur une combinaison de stratégies quotidiennes visant à réduire l’inflammation, protéger les neurones et soutenir la fonction métabolique et cognitive. Les approches suivantes constituent une base solide :
• Optimiser les niveaux d’Akkermansia : Akkermansia muciniphila est un microbe intestinal clé qui soutient l’intégrité de la barrière intestinale, réduit l’inflammation et produit des acides gras à chaîne courte (AGCC) qui nourrissent les cellules du côlon. Les patients atteints d’Alzheimer présentent systématiquement des niveaux plus faibles d’Akkermansia.
Pour optimiser vos niveaux, privilégiez les aliments riches en prébiotiques, les légumes fermentés et les suppléments de qualité pharmaceutique favorisant directement la croissance d’Akkermansia. Adaptez votre apport en glucides à au moins 250 g par jour, ajustez-le selon vos besoins énergétiques, et éliminez les huiles végétales inflammatoires pour renforcer la connexion intestin-cerveau.
• Évitez le gluten et la caséine : Ces protéines perturbent la barrière hémato-encéphalique et augmentent l’activation immunitaire. Le gluten, en particulier, affaiblit cette barrière et permet aux bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine.
Ce qui favorise le déclin cognitif, la neuroinflammation et des maladies telles que Parkinson, anxiété et dépression. Cependant, les graisses laitières, comme le beurre, sont tolérables, ce sont les protéines du lait pasteurisé qui posent problème.
• Inclure des oméga-3 d’origine animale, mais sans excès : Les oméga-3 DHA et EPA protègent contre les dommages cellulaires liés à la maladie d’Alzheimer, réduisant ainsi le risque de développer la maladie ou ralentissant sa progression. Ces acides gras restent des AGPI, il convient donc de les consommer avec modération. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité.
• Obtenir de la vitamine D par le soleil : Une carence en vitamine D est associée à un déclin cognitif rapide et de faibles performances aux tests de mémoire. Une étude a montré une réduction de 40 % du risque de démence avec des niveaux optimaux. La meilleure source est l’exposition solaire raisonnée, visant un taux sanguin de 60 à 80 ng/mL (150 à 200 nmol/L).
Toutefois, il est recommandé d’éliminer les huiles végétales de l’organisme avant de s’exposer au soleil à midi. L’acide linoléique (AL) présent dans la peau s’oxyde au contact des UV, ce qui favorise l’inflammation et endommage les tissus. Pour vous protéger, évitez l’exposition solaire au zénith pendant quatre à six mois, le temps de réduire les niveaux d’AL.
• Maintenir l’insuline à jeun sous 3 : Une insuline élevée de façon chronique favorise l’inflammation cérébrale, la résistance à l’insuline neuronale et le vieillissement accéléré. Réduire vos niveaux d’insuline soutient la fonction mitochondriale et protège la cognition à long terme.
• Consommer des aliments riches en folate : La recherche montre que le folate protège contre la maladie d’Alzheimer. Les légumes restent la meilleure source de folate. Évitez les suppléments comme l’acide folique, version synthétique moins efficace.
• Éliminer le mercure et l’aluminium : Le mercure des amalgames dentaires et l’aluminium des ustensiles, déodorants et adjuvants perturbent la chimie cérébrale. Ces deux métaux sont liés à la neurodégénérescence. Faites appel à un dentiste biologique pour retirer les amalgames en toute sécurité et évitez les produits contenant de l’aluminium.
• Faire de l’exercice régulièrement : L’activité physique augmente le flux sanguin vers le cerveau, améliore la plasticité neuronale et favorise la libération de facteurs neurotrophiques qui soutiennent la survie et le développement des cellules cérébrales.
• Consommer des aliments riches en antioxydants : Les myrtilles sont un excellent exemple. Riches en anthocyanines et polyphénols, elles réduisent le stress oxydatif et améliorent mémoire et fonction cérébrale.
• Stimuler le cerveau quotidiennement : L’apprentissage tout au long de la vie renforce les réseaux neuronaux et aide à retarder le déclin cognitif. Apprendre un instrument, maîtriser une langue ou résoudre des problèmes complexes construit la résilience cérébrale.
• Éviter les anticholinergiques et les statines : Les médicaments anticholinergiques bloquent l’acétylcholine, neurotransmetteur clé de la mémoire et de l’attention. Les statines interfèrent avec la synthèse du cholestérol, épuisent le CoQ10 et entravent le transport des nutriments liposolubles dans le cerveau. Ces deux classes de médicaments ont été associées à un risque accru de démence.
🔎Sources et Références :
- 1 WHO, Dementia
- 2 Alzheimer’s Disease International, January 7, 2022
- 3 National Institute of Aging, Alzheimer’s Disease Fact Sheet
- 4 Int J Mol Sci. 2023 Sep 22;24(19):14450
- 5, 6 Brain Behavior and Immunity Integrative Volume 10, April 2025, 100115
- 7 Oxid Med Cell Longev. 2020 Jan 13;2020:2638703
- 8 Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2012 Sep 5;87(4-5):135–141
- 9 Nutrients. 2023 Jul 13;15(14):3129
- 10 Metabolites 2024, 14(7), 355; doi: 10.3390/metabo14070355
- 11 Aging Med (Milton). 2024 Oct 22;7(5):649–667
- 12 Critical Reviews in Microbiology, 49(2), 151–176
- 13 Am J Lifestyle Med. 2022 Jan 11;16(1):32–35, Abstract
- 14 Alzheimers Dement (Amst). 2023 Mar 1;15(1):e12404, Highlights
- 15 Int J Mol Sci. 2021 Sep 15;22(18):9987, Abstract
- 16 Front Neurosci. 2021 Apr 14;15:661198, Abstract
- 17 Environ Res. 2020 Sep:188:109734
- 18 Front Aging Neurosci. 2023 Aug 4;15:1243869
- 19 Biomolecules. 2021 Jan 14;11(1):102
- 20 Dela J Public Health. 2021 Sep 27;7(4):124–127
- 21 Int. J. Mol. Sci. 2024, 25(23), 12850
- 22 JAMA Intern Med. 2019 Jun 24;179(8):1084–1093